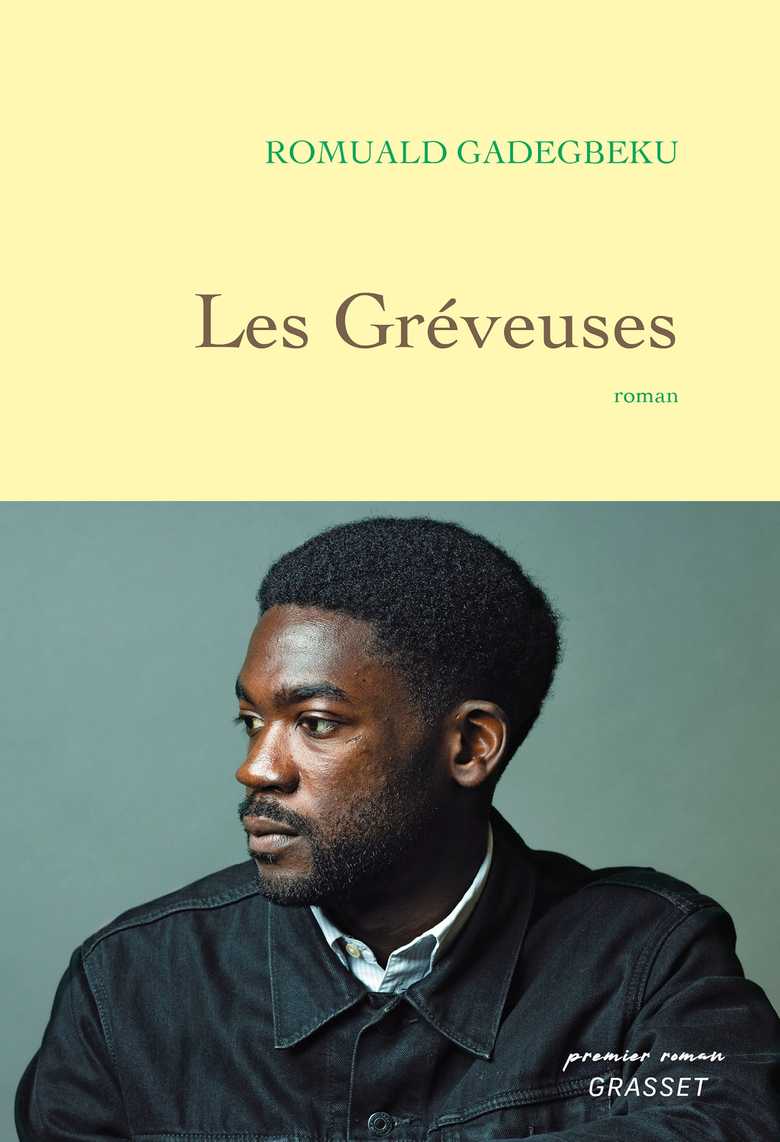
« On a lutté pour aller vers nous-mêmes. » (p.283)
Le premier roman de Romuald Gadegbeku a pour titre : Les Gréveuses. Les Gréveuses avec un G majuscule. Plutôt que « Les Grévistes » l’auteur choisit un néologisme, les Gréveuses. Au-delà de l’effet que produisent ces deux mots, inattendus, sur la couverture des éditions Grasset, ils impriment d’emblée l’idée d’un choix littéraire. Pour raconter l’histoire de ces gréveuses, il faudra modeler la langue française, l’enrichir lexicalement au besoin, parce qu’il n’est pas question de se contenter de puiser dans un dictionnaire figé. Ces gréveuses doivent pouvoir faire entendre leurs propres voix parce qu’elles sont singulières et qu’il ne faut surtout les assourdir, encore moins les taire.
Les Gréveuses est une épopée, sociale, politique et aussi littéraire. Pour suivre la vie de Rita, Diva, Mariama et Aminata, femmes de chambre à l’hôtel Inside qui décident un jour de refuser les conditions de travail insupportables qui leur sont imposées, Romuald Gadegbeku déploie un talent d’écrivain capable d’adapter son écriture au fil des pages du livre, comme pour accompagner Rita, son personnage principal, dans sa marche vers la reconnaissance de ses droits.
Marie NDIAYE, en 2001, a raconté de quelle façon une femme de chambre, démunie, Rosie Carpe se retrouve dans un hôtel de banlieue « à la lisière d’Antony » (p.65)[1] exploitée et abusée par son patron. La lutte sociale des femmes de chambre, menée avec l’aide d’Amado, le syndicaliste, n’est pas un nouveau sujet. Leur employeur, Myriad, a sous-traité à « Ménage à la française » les emplois de ces femmes, noires. Elles sont payées à la chambre et se tuent (le mot n’est pas trop fort) à la tache pour un salaire de misère.
Romuald Gadegbeku ne raconte pas leur histoire, il la fait vivre, il la fait éprouver. Ses phrases sont souvent courtes (au début du livre), elles suivent le rythme accéléré de la vie de ces femmes constamment actives, constamment occupées, exténuées de fatigue, à la fois employées et mamans. Les maris sont absents. Elles ont tout à assumer seules. Le livre les montre magnifiques, tendres et courageuses. Dans le passage qui suit, Dossier est le surnom que Rita donne à son fils Christian.
« Le petit garçon ne pouvait s’endormir que sur le dos à Rita. Dessus, il suait, riait, vibrait en même temps que Maman. Dès que la mère passait le seuil de l’appartement, il réclamait son dos. Les négociations se déroulaient dans un dialecte de gémissements suivi de pleurs auquel la mère finissait toujours par céder. Dossier squattait son dos même pendant les tâches ménagères. Rita plongeait sa serpillière dans le sol avec le petit sur le dos. Elle se baissait, briquait, balayait l’appartement tel un être hybride : deux têtes, quatre bras, quatre jambes, dont une moitié croissait, et l’autre se fanait, mère et travailleuse, en même temps. Malgré les secouements dus aux besognes, le petit était bien sur le tour de maman. » (p.10)
Sur le piquet de grève, devant l’hôtel, elles sont peu nombreuses. D’autres femmes, sans doute encore plus pauvres qu’elles, sont embauchées pour les remplacer. Cela n’arrêtera pas la grève. La vie qui s’installe dans la chaleur de l’été les montre solidaires, les voix se mêlent, les odeurs des plats préparés, détaillés, succulents, embaument les pages du livre, on plonge ses doigts dans les sauces, on ne sait plus qui rapporte ce récit, si le narrateur/auteur est si proche de ces femmes, se dit-on, c’est qu’il doit être au milieu d’elles et qu’il s’essuie lui-même les doigts qu’il a trempés dans le mafé. La première personne du singulier se glisse parfois subrepticement dans le corps du texte.
À Douarnenez, en Bretagne, des femmes, sardinières, ont mené, elles aussi, un combat mémorable pour revendiquer de ne pas mourir un peu chaque jour au travail. C’était pendant l’hiver 1824. Leur détermination force le respect.
https://www.douarnenez.bzh/1924-2024-le-centenaire-des-greves-des-sardinieres/
Les Gréveuses du livre de R.Gadegbeku, cousines des sardinières douarnenistes, méritent, elles aussi, leur majuscule. Le combat qu’elles mènent pour échapper au tragique qu’on veut leur imposer est simplement légitime.
« La lutte toujours pour tenir le rythme d’une vie s’en allant trop vite. Puis des verbes en er à répéter. Ce sont les membres de Rita qui s’abîment à conjuguer les efforts : tirer, se plier, s’agenouiller, s’étirer, se déplier, pousser, répéter, répéter, répéter, frotter la faïence avec la brosse à poil dur, ses éclaboussures se jettent sur sur son visage, elle les efface d’un coup d’avant-bras, le produit chimique fait son effet, maintenant la serpillière tournoie sur les carreaux, d’autres coups d’yeux sur l’heure, la poubelle est vide, ça a l’air propre, mais on ne sait jamais. Rita vérifie qu’un cheveu n’ait pas été oublié, récemment une fille avait changé d’hôtel pour ça. C’est bon. » (p.145-146)
Ces femmes se battent aussi (d’abord ?) pour que leurs enfants aient un meilleur avenir qu’elles. Dans la cour devant l’immeuble où vit Rita et ses deux enfants, Christian retrouve ses copains. La langue qu’il parle avec eux n’est pas celle qu’il partage avec sa mère. De cette langue, complexe, sonore, bourrée d’onomatopées, sourd le danger. Les dialogues qu’on lit, que l’on a du mal à bien suivre parce que leur sens nous échappe en partie, instillent une nouvelle forme de tragique. Un fatum à laquelle la pratique de cette langue ne permettra pas d’échapper semble peser sur cette génération de jeunes gens désœuvrés.
Ce qui court dans ce livre de 284 pages, et qui fait qu’on ne le quitte pas, c’est la profonde certitude que le combat de Rita et de ses amies ne peut pas être un combat vain. Au fur et à mesure des pages, chaque journée de grève, chaque moment de découragement (ou d’épuisement) consolide une détermination qui ne concerne plus simplement des conditions de travail. On leur a accordé 1% d’augmentation ! La langue de R.Gadegbeku accompagne la quête philosophique de Diva et Rita qui viennent partager des moments de prière. Son style sollicite davantage les images, ne nourrit des références culturelles des villages et peu à peu pose la question de ce qui restera de la grève :
« Elle [c’est Diva qui parle] se demande si elle ressentira la même euphorie, le même attachement inébranlable aux autres, la même stimulation de recherche perpétuelle de solutions qui élève, une fois que tout cela sera terminé. Sûrement. La grève est un état, avant d’être un moment. » (p.214)
En refusant des conditions de travail qui sont des atteintes à leur dignité, ces femmes de chambre entrainent d’autres femmes. Elles se ressemblent, ont perdu leurs rêves, en construisent de nouveaux, tout aussi fragiles, se heurtent à un capitalisme aveugle qui n’a que faire de leur corps douloureux. Leur combat est celui de Sysiphe.
Les longues pages qui rapportent les rêves de Rita sont magnifiques, elles rendent compte des questionnements intérieurs de cette femme exceptionnelle. Entre fantasmagorie et poésie, les lignes entremêlent la réalité d’une forêt que la jeune femme a peut-être parcourue autrefois, dans son enfance, et imagination prémonitoire d’un danger qui jamais ne s’éloigne d’elle. Y puiser de l’énergie ? Se heurter au désespoir face à la complexité de ce qu’elle vit au quotidien ?
Si la grève gagne en ampleur parce que le nombre des grévistes a considérablement grossi, l’espoir d’un combat vainqueur ne comblera jamais la douleur liée au malheur. Le malheur d’être pauvre. Le fatalisme qui rôde. Elle est un désastre auquel le destin de chacune de ces femmes est lié. Rita est la figure de cette épopée contemporaine : à la fois ordinaire et sublime.
« La victoire, c’est ce qu’elles vivent à travers leur lutte, migrations intérieures, ce qu’elles ont vécu sur un territoire qui leur est inaccessible à eux [les patrons de Myriad], là où elles ne pourront jamais sanctionner aucune victoire. » (p.283)
Sonia Le Moigne-Euzenot
[1] Marie Ndiaye, Rosie Carpe, Paris, les éditions de minuit, 2001.
épopée contemporaine roman social romuald gadegbeku sonia le moigne euzenot Togo

Commentaires récents